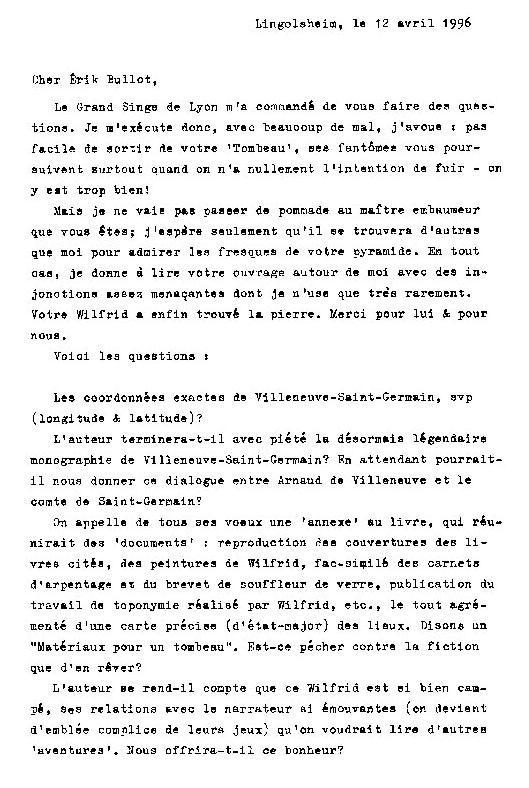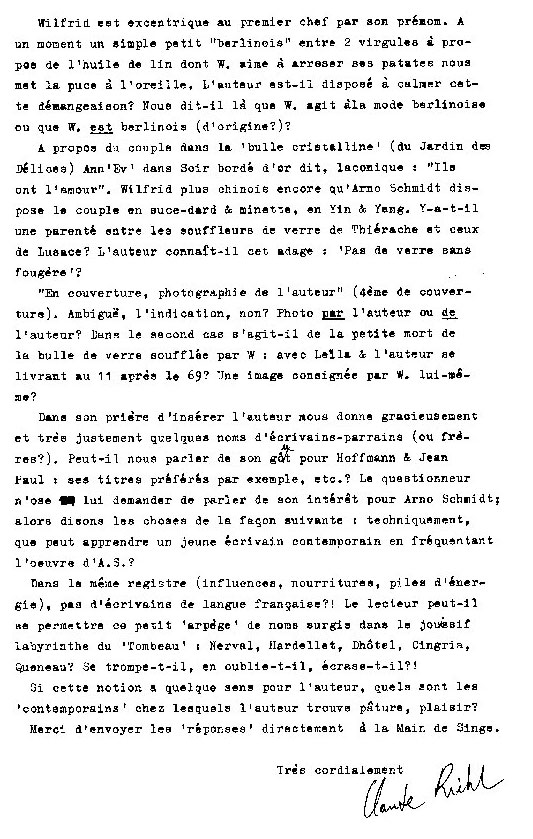Toucher le nerf
À la suite de la publication du Tombeau pour un excentrique, en 1996 chez Deyrolle, cet entretien a été publié dans la revue La Main de Singe, à l'invitation de Claude Riehl et Dominique Poncet. Je tiens à rendre hommage ici à Claude Riehl, disparu brutalement en 2006, grand traducteur de l'écrivain allemand Arno Schmidt et amateur de littérature allemande expressionniste. Dominique Poncet poursuit l'aventure passionnante de sa revue sur son site La Main de Singe.
1.
 Le Tombeau est le rejeton d’un projet plus vaste à l’origine, conçu comme un roman encyclopédique, feuilletonnesque, qui devait rassembler les biographies de nombreux personnages excentriques, réels ou imaginaires, selon une structure complexe, inspirée du jeu de l’oie. Ce projet ne connut jamais d’achèvement (il n’est pas abandonné pour autant). Rebelle par nature à un programme trop strict, sec devant la contrainte, j’accumulais pages, récits, fictions — sans conviction. Je cherchais un lien organique entre l’écriture et l’invention mais celui-ci se dérobait à mesure.
Le Tombeau est le rejeton d’un projet plus vaste à l’origine, conçu comme un roman encyclopédique, feuilletonnesque, qui devait rassembler les biographies de nombreux personnages excentriques, réels ou imaginaires, selon une structure complexe, inspirée du jeu de l’oie. Ce projet ne connut jamais d’achèvement (il n’est pas abandonné pour autant). Rebelle par nature à un programme trop strict, sec devant la contrainte, j’accumulais pages, récits, fictions — sans conviction. Je cherchais un lien organique entre l’écriture et l’invention mais celui-ci se dérobait à mesure.
Recette ou mode d’emploi : donner à voir ou à lire les « Matériaux » du Tombeau pour un excentrique revient-il à dévoiler ou bien à recouvrir sa préparation ? Je répondrai ici, autant que faire se peut, aux questions attentives et bienveillantes de Claude Riehl et Dominique Poncet.
 Le Tombeau est le rejeton d’un projet plus vaste à l’origine, conçu comme un roman encyclopédique, feuilletonnesque, qui devait rassembler les biographies de nombreux personnages excentriques, réels ou imaginaires, selon une structure complexe, inspirée du jeu de l’oie. Ce projet ne connut jamais d’achèvement (il n’est pas abandonné pour autant). Rebelle par nature à un programme trop strict, sec devant la contrainte, j’accumulais pages, récits, fictions — sans conviction. Je cherchais un lien organique entre l’écriture et l’invention mais celui-ci se dérobait à mesure.
Le Tombeau est le rejeton d’un projet plus vaste à l’origine, conçu comme un roman encyclopédique, feuilletonnesque, qui devait rassembler les biographies de nombreux personnages excentriques, réels ou imaginaires, selon une structure complexe, inspirée du jeu de l’oie. Ce projet ne connut jamais d’achèvement (il n’est pas abandonné pour autant). Rebelle par nature à un programme trop strict, sec devant la contrainte, j’accumulais pages, récits, fictions — sans conviction. Je cherchais un lien organique entre l’écriture et l’invention mais celui-ci se dérobait à mesure.La maison de mes grands-parents fut mise en vente. Lors d’une ultime visite à ma grand-mère, je dressai un inventaire maniaque, exhaustif, de cette demeure. Ce fil descriptif, par associations d’idées, digressions et greffes successives, s’est étoffé peu à peu — de juillet 1990 à octobre 1994, après moult repentirs et abandons — pour former le Tombeau, rejetant dans l’ombre le projet initial, momentanément délaissé. Le Testament d’un excentrique de Jules Verne imagine un jeu de l’oie à l’échelle des États-Unis où chaque état représente une case. Le testament est devenu un tombeau, le territoire une maison.
Je fus donc amené — à mon insu ? — à donner une forme différente, sinon contraire, à mon écriture, en passant d’une écriture à contrainte, programmatique, inspirée peu ou prou des exercices oulipiens, à un travail d’épaississement (comme on le dit d’une sauce) autour d’un noyau fortement subjectif, autobiographique. La règle du jeu devint une succession : au double sens de la suite des objets rencontrés lors de la visite de cette maison dont le roman dresse l’inventaire, et de la transmission d’une histoire familiale (celle d’un grand-père excentrique) dont le roman témoigne. Succession toutefois débridée, éruptive, explosive (séquences, rêves, souvenirs), grave et bouffonne, selon la corde sensible tendue par la mémoire. Les deux lignes — voie sèche dans la construction, voie humide dans le lyrisme — se sont croisées, sans préméditation : découpe par chapitres brefs (que j’appelai « tableaux » ou « séquences »), musicalisation des motifs. Bref, toute une technique pour joindre les deux bouts.
Le mélange des deux registres a provoqué également le caractère hybride des personnages du roman. Alors que les personnages du projet initial étaient résolument soit fictifs, soit réels — certains figurent dans un essai, Jardins-rébus —, ceux du Tombeau seront pétris de cette contradiction — outrés, forcés, mêlant le vrai au faux, transposés. Ce travail d’épaississement s’accompagna d’une construction par instants lyriques, enchaînés comme les vignettes d’une machinerie optique. Touches successives. Et parfois tout à trac : fusées ! Émotion produite par artifice. L’émotion est un chronomètre, semblable à celui caché dans la main de Stan Laurel pour régler ses gags. Montrer à la fois l’effet spectaculaire et sa fabrication. L’ombre chinoise, vue depuis l’envers du décor, d’où l’épanchement de la poésie dans la réalité dont le cinéma offre, paradoxalement, des modèles : Keaton, Vigo, Jerry Lewis ou Buñuel par exemple qui pratiquent une esthétique de l’irruption et du surgissement. J’apprécie beaucoup en littérature le caractère visuel, voire visionnaire, des séquences, caractère qui suppose un fort souci de spatialisation. J’aime que la littérature cadre — la page, la découpe narrative en séquences mais aussi le lieu physique qu’elle invente et produit. Une cartographie qui permet de s’y retrouver, comme à la lecture d’un guide de randonnée. Littérature d’arpentage, en somme.
 J’ai dû lire, pour écrire — à l’image du copiste que fut Wilfrid. Sa bibliothèque, notamment. J’ai écrit, comme un singe tout fou, mes chapitres au dos des pages des livres de Wilfrid ; les imprimeurs n’y ont pas pris garde, publiant le tout. Je suis friand, comme lecteur, de toute une littérature trouvée, ordinaire, vernaculaire : traités de jardinage, manuels de pêche, d’astronomie, leçons de choses, dictionnaires illustrés, récits de voyage, livres pour enfants mais aussi biographies d’hommes plus ou moins célèbres (magnats du pétrole, marchands d’armes, créateurs d’hôtels, missionnaires protestants, promoteurs de spectacles forains), romans populaires (Leroux, Leblanc, Le Rouge), prose ésotérique, livres à compte d’auteur. J’aime le papier imprimé — à l’instar de Jean-Paul, dans son livre extraordinaire, la Vie de Fibel, collectant les papiers trouvés du polygraphe Fibel, fragments lacunaires de livres déjà écrits, utilisés par les paysans pour obscurcir une fenêtre ou confectionner des cornets de café. Littérature fabriquée avec des fragments prélevés directement dans la réalité, déjà littérature. Jean-Paul, notre moderne.
J’ai dû lire, pour écrire — à l’image du copiste que fut Wilfrid. Sa bibliothèque, notamment. J’ai écrit, comme un singe tout fou, mes chapitres au dos des pages des livres de Wilfrid ; les imprimeurs n’y ont pas pris garde, publiant le tout. Je suis friand, comme lecteur, de toute une littérature trouvée, ordinaire, vernaculaire : traités de jardinage, manuels de pêche, d’astronomie, leçons de choses, dictionnaires illustrés, récits de voyage, livres pour enfants mais aussi biographies d’hommes plus ou moins célèbres (magnats du pétrole, marchands d’armes, créateurs d’hôtels, missionnaires protestants, promoteurs de spectacles forains), romans populaires (Leroux, Leblanc, Le Rouge), prose ésotérique, livres à compte d’auteur. J’aime le papier imprimé — à l’instar de Jean-Paul, dans son livre extraordinaire, la Vie de Fibel, collectant les papiers trouvés du polygraphe Fibel, fragments lacunaires de livres déjà écrits, utilisés par les paysans pour obscurcir une fenêtre ou confectionner des cornets de café. Littérature fabriquée avec des fragments prélevés directement dans la réalité, déjà littérature. Jean-Paul, notre moderne.
 J’ai dû lire, pour écrire — à l’image du copiste que fut Wilfrid. Sa bibliothèque, notamment. J’ai écrit, comme un singe tout fou, mes chapitres au dos des pages des livres de Wilfrid ; les imprimeurs n’y ont pas pris garde, publiant le tout. Je suis friand, comme lecteur, de toute une littérature trouvée, ordinaire, vernaculaire : traités de jardinage, manuels de pêche, d’astronomie, leçons de choses, dictionnaires illustrés, récits de voyage, livres pour enfants mais aussi biographies d’hommes plus ou moins célèbres (magnats du pétrole, marchands d’armes, créateurs d’hôtels, missionnaires protestants, promoteurs de spectacles forains), romans populaires (Leroux, Leblanc, Le Rouge), prose ésotérique, livres à compte d’auteur. J’aime le papier imprimé — à l’instar de Jean-Paul, dans son livre extraordinaire, la Vie de Fibel, collectant les papiers trouvés du polygraphe Fibel, fragments lacunaires de livres déjà écrits, utilisés par les paysans pour obscurcir une fenêtre ou confectionner des cornets de café. Littérature fabriquée avec des fragments prélevés directement dans la réalité, déjà littérature. Jean-Paul, notre moderne.
J’ai dû lire, pour écrire — à l’image du copiste que fut Wilfrid. Sa bibliothèque, notamment. J’ai écrit, comme un singe tout fou, mes chapitres au dos des pages des livres de Wilfrid ; les imprimeurs n’y ont pas pris garde, publiant le tout. Je suis friand, comme lecteur, de toute une littérature trouvée, ordinaire, vernaculaire : traités de jardinage, manuels de pêche, d’astronomie, leçons de choses, dictionnaires illustrés, récits de voyage, livres pour enfants mais aussi biographies d’hommes plus ou moins célèbres (magnats du pétrole, marchands d’armes, créateurs d’hôtels, missionnaires protestants, promoteurs de spectacles forains), romans populaires (Leroux, Leblanc, Le Rouge), prose ésotérique, livres à compte d’auteur. J’aime le papier imprimé — à l’instar de Jean-Paul, dans son livre extraordinaire, la Vie de Fibel, collectant les papiers trouvés du polygraphe Fibel, fragments lacunaires de livres déjà écrits, utilisés par les paysans pour obscurcir une fenêtre ou confectionner des cornets de café. Littérature fabriquée avec des fragments prélevés directement dans la réalité, déjà littérature. Jean-Paul, notre moderne.J’attends de la littérature la possibilité de toucher le nerf. Que cela doive en passer par le roman des origines, je n’en vois pas clairement la nécessité. Mais c’est un fait. Je n’ai pu tenter l’exercice de la littérature qu’en y recourant. Fouiller le lieu commun, creuser la source, affronter la chronique familiale, frôler différents registres contradictoires — fiction et documentaire, histoire et géographie. Dénuder le nerf, disent les physiologistes ; dénuder le procédé, selon les formalistes russes. Écorcher : rendre visible, à la pointe du stylet. Confronter une exigence lyrique avec une écriture réflexive, ironique, au tempo heurté comme une danse propre à fabriquer l’émotion. J’apprécie beaucoup, en matière d’essais de technique littéraire, les Calculs d’Arno Schmidt et les écrits des Formalistes russes, avec une prédilection particulière pour Victor Chklovski.
J’aime que le monde affleure sous un livre ; il pourrait même à tous égards le pulvériser, le trouer. Le livre n’est pas un écran, ni une lunette — plutôt plaque sensible, lieu de porosité. Il ouvre au monde qui le traverse à son tour. Un gisement d’ondes. Que la sensation vienne irriguer, drainer le cours de la lecture comme une pluie d’étoiles. De même en photographie, j’aime qu’un morceau du monde transpire sous la peau. Cette impression, je l’éprouve en lisant, entre autres, pour citer des auteurs de langue française : Nerval, Giono, Queneau, Cendrars, Larbaud, Cingria, André Druelle. Trouver la bonne distance. On peut mesurer la littérature en termes optico-photographiques : justesse du point de vue, instant décisif, vitesse d’obturation, luminosité, découpe du cadre. Justesse réciproque de la langue et de l’émotion. J’ai trouvé en Arno Schmidt un exemple stimulant. Comme Dziga Vertov souhaitait des films qui suscitent d’autres films, Arno Schmidt écrit pour susciter d’autres livres. Il ouvre un seuil. J’ai toujours été frappé par sa volonté d’être au plus près des sensations, d’une manière quasi naturaliste (la page pouvant représenter, par sa disposition graphique, la somme simultanée des perceptions locales), la précision du trait (son montage par instantanés), la vitesse d’écriture qui produit l’exultation étonnée du lecteur. La proximité au monde est chez lui littéralement fabuleuse.
J’aime que le monde affleure sous un livre ; il pourrait même à tous égards le pulvériser, le trouer. Le livre n’est pas un écran, ni une lunette — plutôt plaque sensible, lieu de porosité. Il ouvre au monde qui le traverse à son tour. Un gisement d’ondes. Que la sensation vienne irriguer, drainer le cours de la lecture comme une pluie d’étoiles. De même en photographie, j’aime qu’un morceau du monde transpire sous la peau. Cette impression, je l’éprouve en lisant, entre autres, pour citer des auteurs de langue française : Nerval, Giono, Queneau, Cendrars, Larbaud, Cingria, André Druelle. Trouver la bonne distance. On peut mesurer la littérature en termes optico-photographiques : justesse du point de vue, instant décisif, vitesse d’obturation, luminosité, découpe du cadre. Justesse réciproque de la langue et de l’émotion. J’ai trouvé en Arno Schmidt un exemple stimulant. Comme Dziga Vertov souhaitait des films qui suscitent d’autres films, Arno Schmidt écrit pour susciter d’autres livres. Il ouvre un seuil. J’ai toujours été frappé par sa volonté d’être au plus près des sensations, d’une manière quasi naturaliste (la page pouvant représenter, par sa disposition graphique, la somme simultanée des perceptions locales), la précision du trait (son montage par instantanés), la vitesse d’écriture qui produit l’exultation étonnée du lecteur. La proximité au monde est chez lui littéralement fabuleuse.
J’aime que la littérature se tienne en équilibre instable sur cette ligne de partage, fragile, impure, balbutiante — d’où la bouffonnerie (les personnages les plus beaux chez Jean-Paul, assurément, prompt aux larmes), l’humour, le merveilleux qui sourd du réel (les contes, et surtout ceux des Mille et une Nuits), le fantastique qui fait se côtoyer le terrible et l’obscène, l’irrationnel et le burlesque (chez Hoffmann le partage entre deux mondes, en déflagration mutuelle — le Chat Murr ou Princesse Brambilla).
2.
Que dire ou dévoiler des « Matériaux » du Tombeau ? Des peintures de Wilfrid, des couvertures des livres cités, de ses lettres, photographies, carnets d’arpentage, journaux intimes, de son brevet de souffleur de verre, de son travail de toponymie, de sa monographie de Villeneuve-Saint-Germain ?
« La Ville de Villeneuve-Saint-Germain est située dans la vallée de l’Aisne à 1° 1’ 25” de longitude Est et à 40° 22’ 28” de latitude Nord. La rivière d’Aisne la sépare, au Nord de la commune de Bucy-le-Long, au Nord ouest de Crouy, puis elle est bordée à l’Ouest et au Sud par Soissons de laquelle elle est séparée par l’avenue de Reims sur 600 mètres, au Sud la route Nationale n° 31 la sépare de Billy-sur-Aisne, à l’Est elle a pour voisine Vénizel. » (Monographie de Villeneuve-Saint-Germain).
Wilfrid apparaîtra-t-il dans de nouvelles aventures ? N’est-il pas, désormais, définitivement embaumé ? Sans doute les fabricants de feuilletons, littéraires ou cinématographiques, devaient-ils souvent se demander : « comment faire réapparaître, pour les besoins de la fable, le héros malencontreusement disparu dans l’épisode précédent ? » Mais Wilfrid étant déjà revenu d’entre les morts, pourquoi n’apparaîtrait-il pas une seconde fois dans un achèvement, par exemple, du projet initial, ce roman encyclopédique et feuilletonnesque, en compagnie d’une confrérie d’excentriques picards ? Occasion d’offrir au lecteur le dialogue entre Arnaud de Villeneuve et le comte de Saint-Germain ? Sait-on jamais ?
Je suis l’auteur de la photographie de couverture du Tombeau.
Le tableau de Jérôme Bosch préféré par mon grand-père n’était pas le Jardin des délices — quoique l’opération érotico-alchimique dont je fus l’acteur semble de toute évidence inspirée par cette image — mais l'Escamoteur dont il avait punaisé, à son chevet, une reproduction noire et blanche. Je n’ai jamais su quel était le motif exact de son intérêt : s’identifiait-il à l’escamoteur précisément, au gredin (complice du précédent) qui dérobe sa bourse au spectateur crédule, ou au spectateur lui-même ? La question reste ouverte. J’ignore tout lien entre Wilfrid et les souffleurs de verre de Lusace, et ne connais pas l’adage : « Pas de verre sans fougère ».
Wilfrid est-il berlinois ? Je n’ose l’infirmer totalement. Car d’où lui venait cette étrange habitude ? Il est vrai qu’il consommait sans vergogne d’inhabituels breuvages. En ingurgitant l’huile de lin et l’essence de térébenthine, ne réalisait-il pas l’union du soufre et du mercure ? Mais il se peut aussi que ses origines soient tout simplement germaniques, à en juger d’après son singulier prénom. Il est trop tard — ou trop tôt — pour en décider.
« Aujourd’hui je taille ses crayons (piqués dans l’armoire à l’insu de mon oncle) et les éclats de bois volant dans la pénombre comme des lucioles taraudent sa mémoire, prompte à s’évanouir à la moindre biffure qui ternit son aura, détruisant peu à peu ses indices, usant la pointe du crayon à chaque entaille, poussant Wilfrid du coude un peu plus dans l’oubli, sournois, en brisant ses empreintes qui palpitent entre mes doigts, ses crayons affûtés pour tracer son portrait qui s’étoffe à mesure qu’il détruit les traces de son passage. » (Tombeau pour un excentrique)
À l’image des crayons de Wilfrid subtilisés pour tracer son portrait, j’imaginais l’écriture susceptible d’accomplir le deuil en transformant poétiquement les traces de sa disparition. Répondant aux questions de Claude Riehl et Dominique Poncet, questionné sur ma faculté de faire disparaître Wilfrid, me voici tenu à une invention seconde du Tombeau. L’inachèvement du projet initial, dont je pensais avoir trouvé une parade avec ce Tombeau, se prolonge sous une forme nouvelle — renvoyant l’écriture à un impossible deuil.
Que dire ou dévoiler des « Matériaux » du Tombeau ? Des peintures de Wilfrid, des couvertures des livres cités, de ses lettres, photographies, carnets d’arpentage, journaux intimes, de son brevet de souffleur de verre, de son travail de toponymie, de sa monographie de Villeneuve-Saint-Germain ?
J’ai dû inventer mon grand-père pour le trouver. Il m’a été donné deux fois. Démêler le vrai du faux serait maintenant périlleux. Tout est exact, en un sens, dans la mémoire enfantine qui est mienne.
« La Ville de Villeneuve-Saint-Germain est située dans la vallée de l’Aisne à 1° 1’ 25” de longitude Est et à 40° 22’ 28” de latitude Nord. La rivière d’Aisne la sépare, au Nord de la commune de Bucy-le-Long, au Nord ouest de Crouy, puis elle est bordée à l’Ouest et au Sud par Soissons de laquelle elle est séparée par l’avenue de Reims sur 600 mètres, au Sud la route Nationale n° 31 la sépare de Billy-sur-Aisne, à l’Est elle a pour voisine Vénizel. » (Monographie de Villeneuve-Saint-Germain).
Wilfrid apparaîtra-t-il dans de nouvelles aventures ? N’est-il pas, désormais, définitivement embaumé ? Sans doute les fabricants de feuilletons, littéraires ou cinématographiques, devaient-ils souvent se demander : « comment faire réapparaître, pour les besoins de la fable, le héros malencontreusement disparu dans l’épisode précédent ? » Mais Wilfrid étant déjà revenu d’entre les morts, pourquoi n’apparaîtrait-il pas une seconde fois dans un achèvement, par exemple, du projet initial, ce roman encyclopédique et feuilletonnesque, en compagnie d’une confrérie d’excentriques picards ? Occasion d’offrir au lecteur le dialogue entre Arnaud de Villeneuve et le comte de Saint-Germain ? Sait-on jamais ?
Je suis l’auteur de la photographie de couverture du Tombeau.
Le tableau de Jérôme Bosch préféré par mon grand-père n’était pas le Jardin des délices — quoique l’opération érotico-alchimique dont je fus l’acteur semble de toute évidence inspirée par cette image — mais l'Escamoteur dont il avait punaisé, à son chevet, une reproduction noire et blanche. Je n’ai jamais su quel était le motif exact de son intérêt : s’identifiait-il à l’escamoteur précisément, au gredin (complice du précédent) qui dérobe sa bourse au spectateur crédule, ou au spectateur lui-même ? La question reste ouverte. J’ignore tout lien entre Wilfrid et les souffleurs de verre de Lusace, et ne connais pas l’adage : « Pas de verre sans fougère ».
Wilfrid est-il berlinois ? Je n’ose l’infirmer totalement. Car d’où lui venait cette étrange habitude ? Il est vrai qu’il consommait sans vergogne d’inhabituels breuvages. En ingurgitant l’huile de lin et l’essence de térébenthine, ne réalisait-il pas l’union du soufre et du mercure ? Mais il se peut aussi que ses origines soient tout simplement germaniques, à en juger d’après son singulier prénom. Il est trop tard — ou trop tôt — pour en décider.
« Aujourd’hui je taille ses crayons (piqués dans l’armoire à l’insu de mon oncle) et les éclats de bois volant dans la pénombre comme des lucioles taraudent sa mémoire, prompte à s’évanouir à la moindre biffure qui ternit son aura, détruisant peu à peu ses indices, usant la pointe du crayon à chaque entaille, poussant Wilfrid du coude un peu plus dans l’oubli, sournois, en brisant ses empreintes qui palpitent entre mes doigts, ses crayons affûtés pour tracer son portrait qui s’étoffe à mesure qu’il détruit les traces de son passage. » (Tombeau pour un excentrique)
À l’image des crayons de Wilfrid subtilisés pour tracer son portrait, j’imaginais l’écriture susceptible d’accomplir le deuil en transformant poétiquement les traces de sa disparition. Répondant aux questions de Claude Riehl et Dominique Poncet, questionné sur ma faculté de faire disparaître Wilfrid, me voici tenu à une invention seconde du Tombeau. L’inachèvement du projet initial, dont je pensais avoir trouvé une parade avec ce Tombeau, se prolonge sous une forme nouvelle — renvoyant l’écriture à un impossible deuil.
Publié dans la Main de Singe, n°20, 1997.